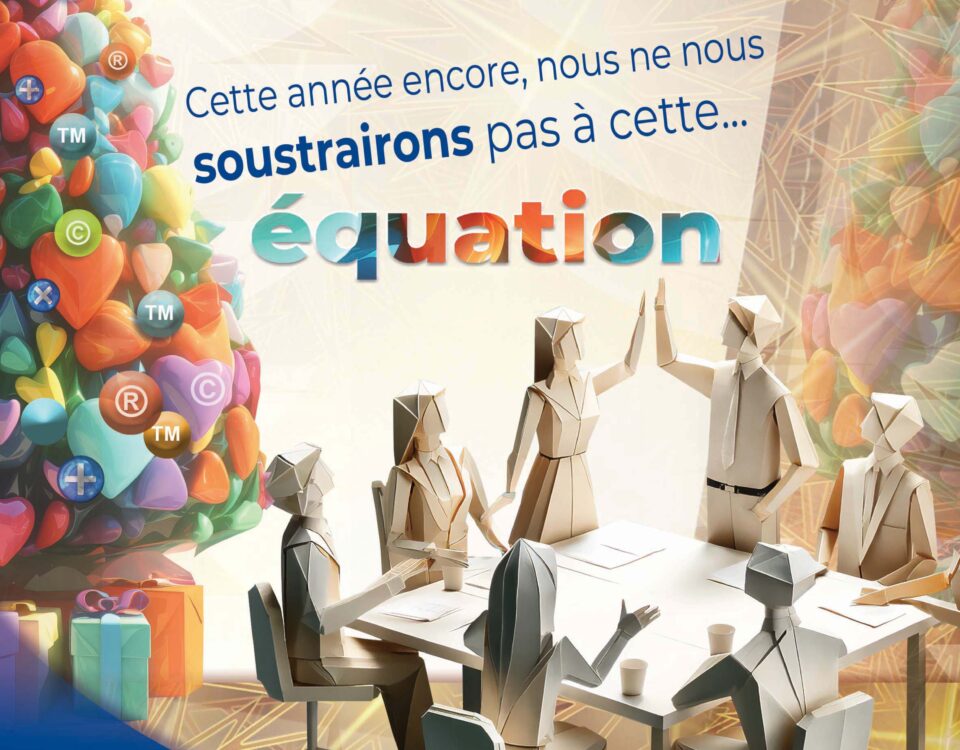Les NFTs et la propriété intellectuelle : où en est-on ?
novembre 13, 2025
Quand les « dupes » s’invitent sous le sapin
décembre 5, 2025
En une dizaine d’années, l’éthique environnementale, l’écologie et l’écoresponsabilité ont profondément transformé le comportement des consommateurs et les stratégies des marques. Elles constituent aujourd’hui des arguments marketing incontournables. Encore faut-il que ces engagements soient sincères : à défaut, les marques s’exposent au risque de greenwashing, ou éco-blanchiment.
Le greenwashing désigne une communication affirmant, directement ou indirectement, qu’un produit ou service présente des qualités écologiques infondées, trompeuses ou impossibles à vérifier. Certaines pratiques visent également à détourner l’attention du public de l’impact réel du produit, souvent bien moins vert qu’annoncé.
Exemples :
• Le packaging vert de AJAX « fête des fleurs », malgré la présence de substances toxiques pour les organismes aquatiques.
• Le label interne « pêche responsable » d’INTERMARCHÉ, alors que le seul écolabel reconnu est celui du MSC.
• L’engagement « Zéro émission de CO₂ d’ici 2050 » d’EASYJET, reposant sur des innovations futures hypothétiques.
• La collection « CONSCIOUS » de H&M, qualifiée d’écoresponsable sans transparence sur la proportion de coton bio recyclé.
Un encadrement réglementaire croissant contre les allégations environnementales trompeuses
En France, plusieurs textes permettent d’encadrer les allégations environnementales et de lutter contre le greenwashing :
Le Code de la consommation : La DGCCRF intensifie ses contrôles et peut prononcer injonctions et sanctions. L’ARPP, quant à elle, accompagne les entreprises dans la correction de leurs communications non conformes.
Le droit des marques : Les offices peuvent refuser une marque à connotation écologique jugée descriptive ou trompeuse.
Exemples :
• WE ARE NATURALS pour des produits pharmaceutiques,
• GREEN CEMENT pour du ciment « écologique ».
Une marque « BIO » peut être acceptée si son libellé est strictement limité à des produits effectivement issus de l’agriculture biologique — charge au déposant d’en apporter la preuve sur la durée.
Les initiatives européennes : Le projet de Green Claims Directive, désormais retiré, avait pour ambition d’imposer la certification des allégations environnementales.
La loi française de 2021 qui :
• interdit la publicité sur les énergies fossiles,
• renforce les sanctions contre l’éco-blanchiment,
• prévoit des amendes atteignant 80% des dépenses de communication,
• impose la publication de la sanction sur divers médias pendant trente jours.
Le rôle des concurrents, des ONG et des consommateurs
La régulation passe aussi par :
• les concurrents, via la dénonciation ou les actions judiciaires ;
• les associations environnementales comme l’ADEME ;
• les consommateurs, notamment les plus jeunes, qui traquent les allégations abusives sur les réseaux sociaux.
Une campagne de communication peut ainsi être ruinée en quelques heures par des révélations sur l’authenticité des engagements « verts ».
Les consommateurs : un pouvoir de plus en plus structurant
Les études démontrent que les clients sont prêts à payer plus cher pour des marques réellement écoresponsables, à condition que ces dernières puissent fournir des preuves. Leur vigilance s’exprime via les actions collectives (ex. : WESSON « 100 % naturelle », CONAGRA Inc., 2011), la vérification des ingrédients via les emballages ou applications dédiées, ou encore l’identification des vrais écolabels certifiés.
Conseils pour les entreprises : bien nommer sa marque et sécuriser sa communication verte
• Éviter les termes tels que « zéro impact », « naturel », « bio », « compostable », ou les logos très connotés (feuilles, abeilles, arbres…) si l’entreprise ne peut démontrer un véritable engagement environnemental.
• S’assurer de pouvoir prouver toutes les allégations communiquées.
• Communiquer de façon transparente, claire et précise.
• Envisager une marque de certification, dont la confiance ne cesse de croître (exemples : MSC pour les pêcheries durables, ou encore LEED pour la construction écologique).
– Sylvie BOYER, Paralégale chez Mark & Law