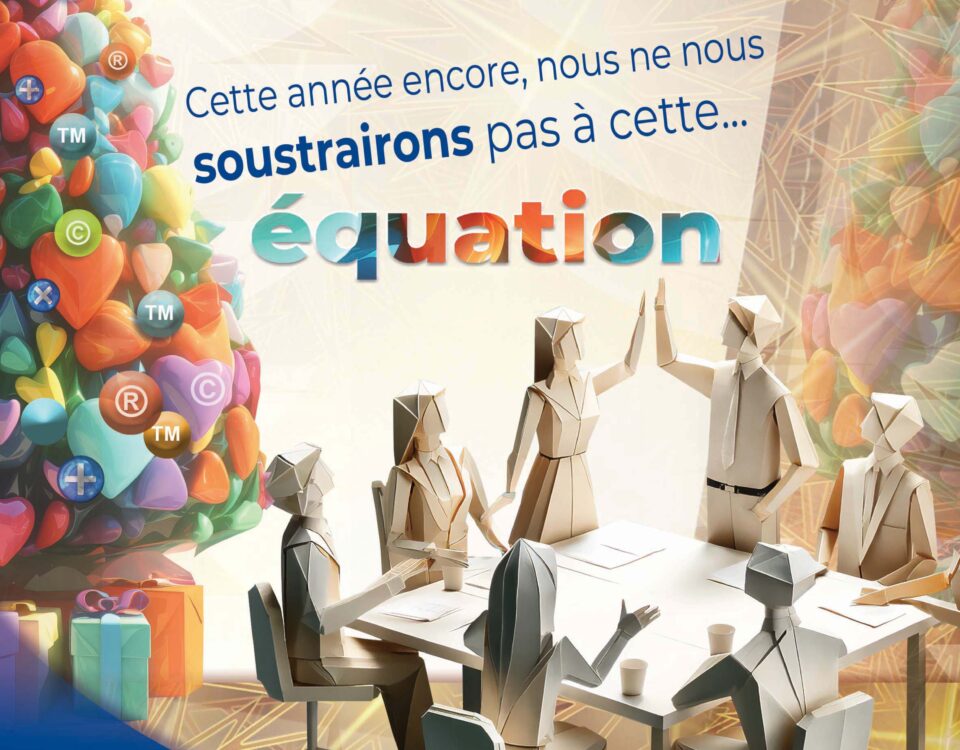Bilan des actions douanières en Europe pour 2024 : privilégiez la surveillance de vos titres de PI
octobre 23, 2025
Les marques qui lavent plus vert que vert
novembre 20, 2025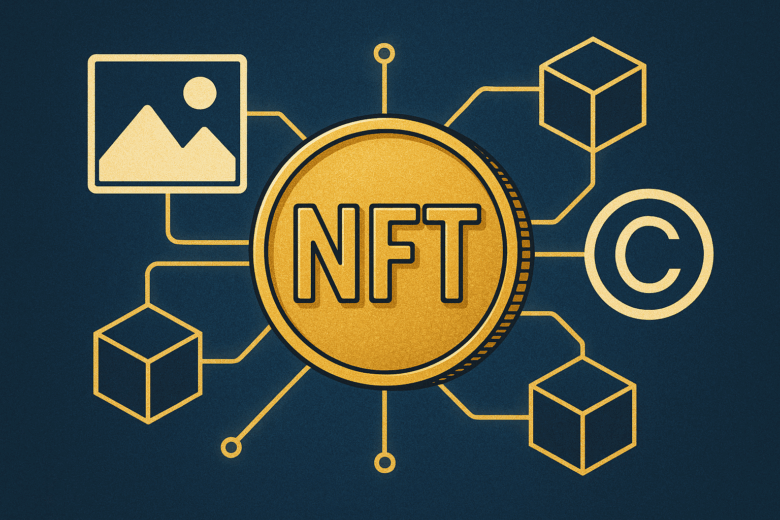
Les NFTs (Non-Fungible Tokens / jetons non-fongibles en français) ont fait irruption sur la scène numérique en promettant de révolutionner la manière dont on détient et échange les œuvres. Mais plusieurs années après l’euphorie initiale, qu’en reste-t-il réellement sur le plan juridique ?
Un NFT est un certificat d’authenticité inscrit sur une blockchain, garantissant la traçabilité d’un fichier numérique. En revanche, il ne confère aucun droit de propriété intellectuelle sur le contenu qu’il représente. L’achat d’un NFT ne donne donc pas nécessairement le droit d’exploiter ou de reproduire l’œuvre associée : seul le titulaire des droits d’auteur en conserve le monopole.
Cette distinction a donné lieu à de nombreux litiges, notamment dans le domaine artistique et de la mode. Certaines marques ont vu leurs créations « tokenisées » sans autorisation, soulevant la question de la contrefaçon dans l’univers virtuel. Les tribunaux commencent à se prononcer : en 2023, la justice américaine a reconnu la responsabilité d’un artiste ayant émis des NFTs représentant les sacs Hermès « Birkin », au motif qu’ils portaient atteinte à la marque.
Aujourd’hui, le marché des NFTs s’est considérablement calmé, mais les enjeux juridiques demeurent. La blockchain offre des perspectives intéressantes en matière de preuve de création ou de traçabilité des œuvres, mais elle ne remplace pas le cadre légal existant.
En somme, les NFTs ont permis de remettre en lumière les principes essentiels du droit de la propriété intellectuelle : ce n’est pas la technologie qui crée le droit, mais le droit qui doit encadrer son usage.
Les NFTs rappellent que, même à l’ère du numérique, les principes fondamentaux de la propriété intellectuelle demeurent essentiels. Si vous souhaitez sécuriser vos créations ou comprendre comment ces nouveaux outils peuvent s’intégrer à votre stratégie, notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller.