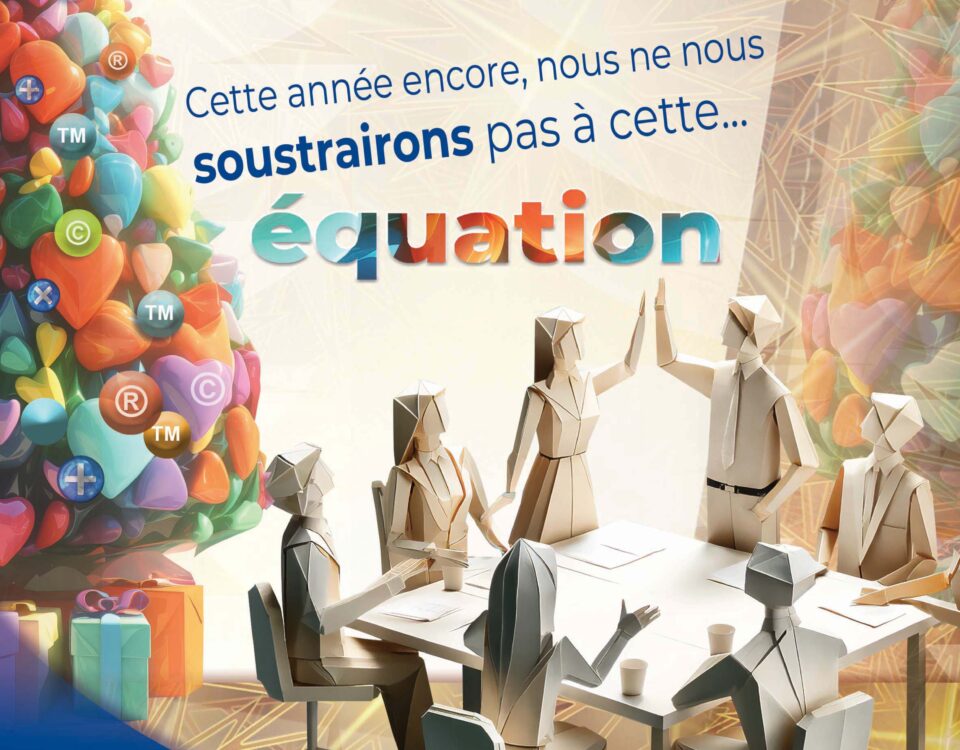Marques et classification : ce qui change en 2026
septembre 11, 2025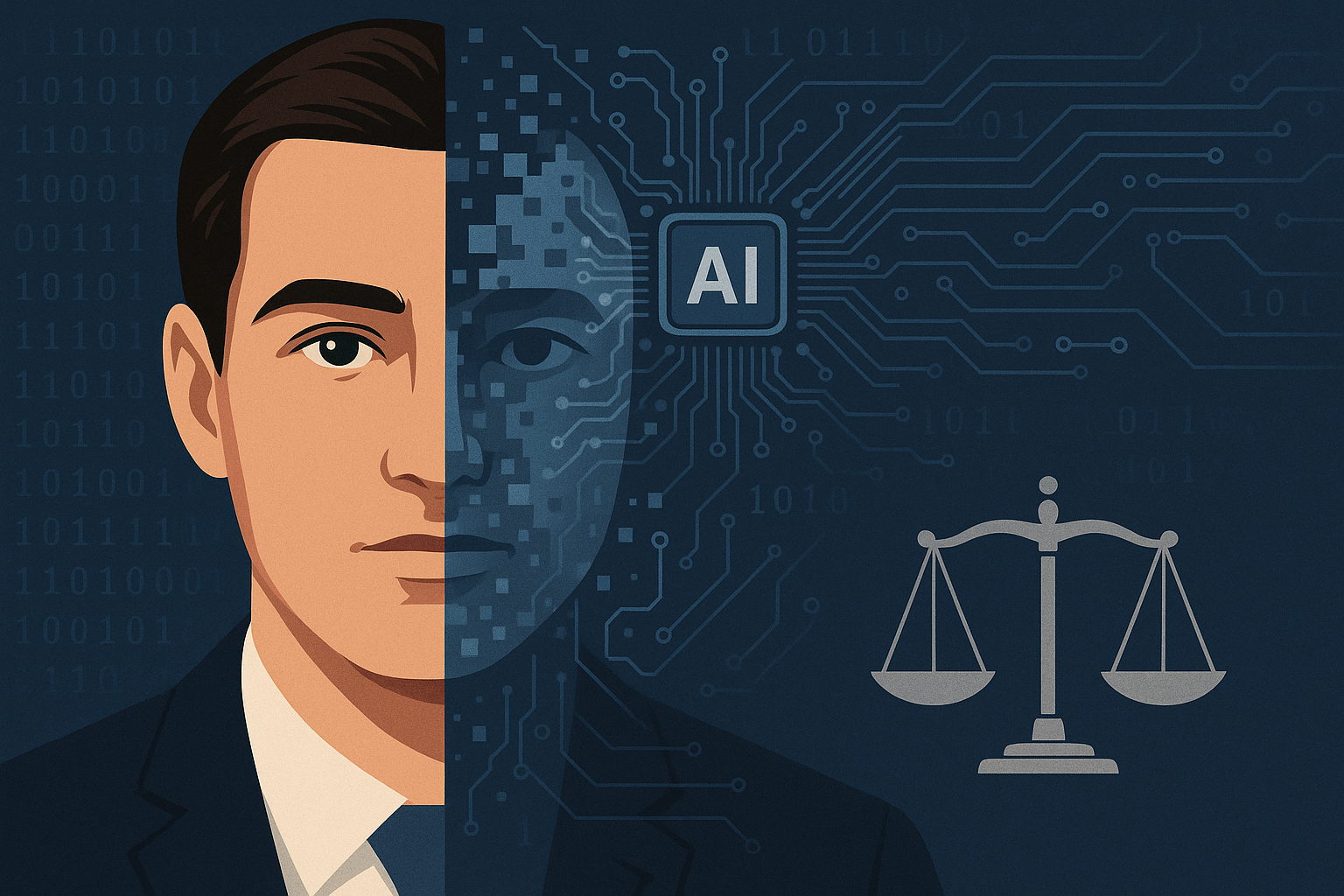
Soyez comme Saint Thomas… mais méfiez-vous de l’IA !
octobre 16, 2025
La blockchain n’est plus seulement associée aux cryptomonnaies : elle s’invite désormais dans le monde de la propriété intellectuelle. En mars 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille (1ʳᵉ ch. civ., 20 mars 2025, RG 23/00046, AZ Factory c/ Valeria Moda) a reconnu pour la première fois qu’un horodatage enregistré sur une blockchain pouvait constituer un commencement de preuve de l’antériorité d’une œuvre
Concrètement, il suffirait d’inscrire dans la blockchain l’empreinte numérique d’un fichier (texte, photo, code source…) pour dater de manière infalsifiable son existence. Cette technologie offre une alternative rapide et peu coûteuse aux dépôts traditionnels tels que l’enveloppe Soleau, le constat d’huissier, dépôt notarié…. Le tribunal a toutefois précisé qu’il s’agissait d’un élément de preuve, et non d’une preuve absolue : son efficacité dépend du faisceau d’indices produits par le demandeur.
Pour les créateurs et les innovateurs, c’est une petite révolution : la preuve d’antériorité, essentielle en cas de litige, devient accessible en quelques clics. La blockchain garantit en effet une traçabilité transparente et sécurisée, sans dépendre d’une autorité centrale.
Reste une question ouverte : la valeur juridique de ces preuves sera-t-elle reconnue de façon uniforme par les juridictions françaises et européennes ? L’affaire marseillaise trace une première voie, mais un cadre harmonisé reste à construire.
Une chose est certaine : avec la blockchain, le droit de la preuve entre dans une nouvelle ère numérique.
– Ghislaine BERTIN, Paralégale et Directrice des opérations chez Mark & Law